 Il y eut un moment où l’Europe bruissait tant de cris de révolution qu’on ne s’entendait plus. Certains tentèrent d’y mettre bon ordre en inventant une dialectique et en lui trouvant des lois. Je me rappelle n’y avoir pas compris grand chose de plus que le désir enthousiaste et grave d’un grand théâtre. Les prétendues lois de la dialectique ressemblaient fort à des principes dramatiques censés montrer comment se déroule l’Histoire ainsi que la manière d’en écrire les pièces les plus terribles mais les plus heureuses.
Il y eut un moment où l’Europe bruissait tant de cris de révolution qu’on ne s’entendait plus. Certains tentèrent d’y mettre bon ordre en inventant une dialectique et en lui trouvant des lois. Je me rappelle n’y avoir pas compris grand chose de plus que le désir enthousiaste et grave d’un grand théâtre. Les prétendues lois de la dialectique ressemblaient fort à des principes dramatiques censés montrer comment se déroule l’Histoire ainsi que la manière d’en écrire les pièces les plus terribles mais les plus heureuses.
Étrangement, le cri de la catastrophe qui résonne si fort aujourd’hui, s’y entendait déjà. Dans les appels que l’on lançait à la Révolution, mi menaces, mi alertes, la catastrophe en son sens grec, un théâtral retournement de situation, en était déjà une péripétie fondamentale. Rien ne faisait Histoire et ne pouvait se dire d’elle sans passer par un renversement. Je me souviens de ce journaliste allemand du nom de Marx chroniquant les de plus en plus proches affaires américaines. J’avais gardé quelques-uns de ses papiers du New York Tribune. Tiens, celui-là : « un observateur attentif de l’histoire ne pouvait pas ne pas remarquer que chaque nouvelle avancée de la puissance esclavagiste était un pas de plus vers sa défaite finale », ou celui-ci : « on constata, à des signes indéniables, que le combat de forces opposées devenant si intense que le rapport de forces devait bientôt se renverser » et celui-là aussi « En dehors de ces phénomènes politiques, il y a un fait manifeste d’ordre statistique et économique qui montre que l’usurpation de l’Union fédérale, au profit des esclavagistes, avait atteint le point où ils devaient reculer de gré ou de force. » Défaite, renversement, point de non-retour, dans le cours tortueux des événements, ce Marx qui s’appelait en fait Engels voyait toujours le moment où une nécessité était atteinte ou approchée : le passage obligé de la catastrophe, moment fatidique où la situation allait se renverser. Quelqu’un qui, comme ce Marx ou ce Engels, guettait l’arrivée des révolutions comme on attend l’arrivée d’un train (toujours en avance ou en retard), gardait toujours un œil sur ce moment d’avant la fin, celui qui en prépare l’issue, qui donne le temps de l’action. Si une sorte de destin habitait toujours l’histoire, l’avance donnée par cette vigilance permettait de peser sur les événements. La Catastrophe y avait son rôle, elle était le signe avant-coureur de la Révolution, le tournant qu’il fallait attendre et saisir pour voir la fin se réaliser. Au milieu des circonvolutions de l’Histoire, le Révolutionnaire ne perdait jamais de vue le temps d’avant la fin du temps. La Catastrophe, aujourd’hui, est devenue le début, le milieu et la fin de notre temps. Et si certains l’appellent encore, y voyant probablement les signes d’une Révolution, la plupart de ceux qui la regardent en face – montrant qu’elle est déjà là ou encore à venir – n’y voient plus plus la cause, la chance, ni même le signe d’un tel événement. Hormis dans les pays arabes qui ont relancé les dés et couru les risques de la Révolution, une alerte a pris le pas sur l’autre. Si l’on veut que la catastrophe ne soit pas le seul orient de notre temps, il va nous falloir imaginer, mettre en avant, d’aussi puissants bouleversements.
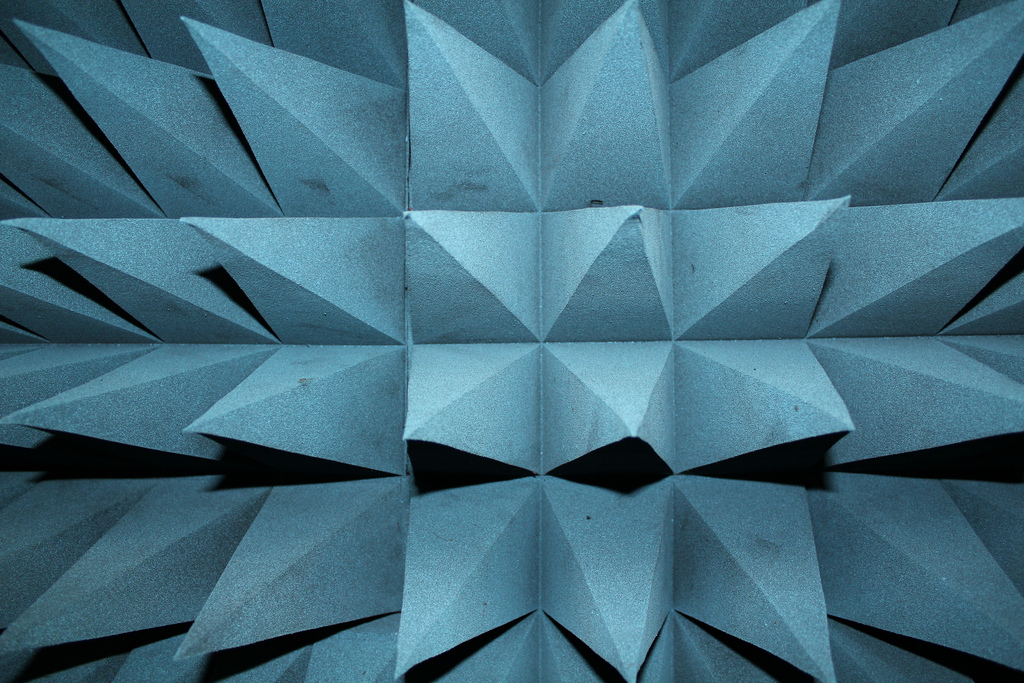 Depuis quand cela nous est-il clamé aux oreilles que nous y sommes − ou presque −, qu’il n’y aura bientôt plus rien de sauvage sur cette planète ? Que le nombre des espèces diminue chaque jour, que l’étendue et la richesse des espaces ouverts décroissent, que les populations se rassemblent, se concentrent et s’étendent en bidonvilles toujours plus nombreux, que les compagnies dévastent sols et sous-sols sous les pleins feux du soleil et qu’enfin, dans le dérisoire cloisonnement de leurs parcs, les États protègent les derniers îlots de nature ? Le temps arrive, prochain, où il n’y aura plus d’expérience possible de la sauvagerie ; plus aucune forêt, réelle ou symbolique, où nous pourrions nous réfugier, nous libérer, nous isoler, nous égarer ou nous faire face. Tout subira et accomplira le destin de l’Occident : se tourner vers où le soleil se couche, décliner vers la nuit et disparaître.
Depuis quand cela nous est-il clamé aux oreilles que nous y sommes − ou presque −, qu’il n’y aura bientôt plus rien de sauvage sur cette planète ? Que le nombre des espèces diminue chaque jour, que l’étendue et la richesse des espaces ouverts décroissent, que les populations se rassemblent, se concentrent et s’étendent en bidonvilles toujours plus nombreux, que les compagnies dévastent sols et sous-sols sous les pleins feux du soleil et qu’enfin, dans le dérisoire cloisonnement de leurs parcs, les États protègent les derniers îlots de nature ? Le temps arrive, prochain, où il n’y aura plus d’expérience possible de la sauvagerie ; plus aucune forêt, réelle ou symbolique, où nous pourrions nous réfugier, nous libérer, nous isoler, nous égarer ou nous faire face. Tout subira et accomplira le destin de l’Occident : se tourner vers où le soleil se couche, décliner vers la nuit et disparaître. « Il y aurait à faire sur les rapports de la philosophie au journalisme à partir de la fin du XVIIIe siècle une étude ». Quand j’eus l’occasion de lire cette phrase de Foucault, il y a quelques années, prononcée dans une de ces plus philosophiques conférences, intitulée par d’autres Qu’est-ce que la critique ?, j’ai été tout de suite étonné de n’avoir jamais pensé à Marx, sous cet angle. Dès ses premières prises de parole publiques dans les journaux rhénans jusqu’aux interventions d’Engels signées Marx dans divers journaux anglais ou américains, l’activité politique et philosophique marxiste (je crois que le Marxisme existe dès cette contrefaçon des noms) s’exerça par un discours public donné dans la presse. Je pensai tout de suite, sans en avoir aucunement la preuve, qu’en plus de nous avoir fourni une œuvre philosophique et économique majeure, Marx était sans doute un des plus grands publicistes du siècle dernier. Je me demandai même comment après tant d’années à me brûler les yeux sur ses textes les plus fameux, L’Idéologie allemande, les Manuscrits de 44, Les luttes de classes en France, les Grundisse, le Capital, etc., j’avais pu faire l’impasse sur son premier texte au sujet du vol de bois ou sur ses interventions dans la Nouvelle Gazette Rhénane (plus tard, bien plus tard, les Éditions la Fabrique eurent l’excellente idée de remettre en lumière ce texte important). Mais sans doute étais-je bien trop préoccupé par tout autre chose à l’époque : non pas tout à fait la Révolution – bien que j’aurais sûrement dit le contraire sur le moment – mais plutôt par l’exacerbation en moi d’une haine à l’endroit de toute vision politique qui acceptait la misère comme une condition insurmontable de l’existence. La question de la pauvreté m’obnubilait. Aussi, appliqué à ces études un peu particulières qui ne séparaient pas, on le voit, ce qui dans l’acquisition du savoir relevait des propositions tout autant que des émotions, je pris par cette distance si particulière aux « choses », autrement dit cette hostilité, la mesure du regard sociologique que l’université préparait par ailleurs en moi – discipline à laquelle depuis plusieurs années je consacrais publiquement mes efforts.
« Il y aurait à faire sur les rapports de la philosophie au journalisme à partir de la fin du XVIIIe siècle une étude ». Quand j’eus l’occasion de lire cette phrase de Foucault, il y a quelques années, prononcée dans une de ces plus philosophiques conférences, intitulée par d’autres Qu’est-ce que la critique ?, j’ai été tout de suite étonné de n’avoir jamais pensé à Marx, sous cet angle. Dès ses premières prises de parole publiques dans les journaux rhénans jusqu’aux interventions d’Engels signées Marx dans divers journaux anglais ou américains, l’activité politique et philosophique marxiste (je crois que le Marxisme existe dès cette contrefaçon des noms) s’exerça par un discours public donné dans la presse. Je pensai tout de suite, sans en avoir aucunement la preuve, qu’en plus de nous avoir fourni une œuvre philosophique et économique majeure, Marx était sans doute un des plus grands publicistes du siècle dernier. Je me demandai même comment après tant d’années à me brûler les yeux sur ses textes les plus fameux, L’Idéologie allemande, les Manuscrits de 44, Les luttes de classes en France, les Grundisse, le Capital, etc., j’avais pu faire l’impasse sur son premier texte au sujet du vol de bois ou sur ses interventions dans la Nouvelle Gazette Rhénane (plus tard, bien plus tard, les Éditions la Fabrique eurent l’excellente idée de remettre en lumière ce texte important). Mais sans doute étais-je bien trop préoccupé par tout autre chose à l’époque : non pas tout à fait la Révolution – bien que j’aurais sûrement dit le contraire sur le moment – mais plutôt par l’exacerbation en moi d’une haine à l’endroit de toute vision politique qui acceptait la misère comme une condition insurmontable de l’existence. La question de la pauvreté m’obnubilait. Aussi, appliqué à ces études un peu particulières qui ne séparaient pas, on le voit, ce qui dans l’acquisition du savoir relevait des propositions tout autant que des émotions, je pris par cette distance si particulière aux « choses », autrement dit cette hostilité, la mesure du regard sociologique que l’université préparait par ailleurs en moi – discipline à laquelle depuis plusieurs années je consacrais publiquement mes efforts.