I

Ivan Aivazovsky, La mer noire, 1881, Gallerie Treyakov, Moscou
« Le port est déjà loin, la terre a disparu. Les paysages que nous avons quittés sont encore familiers et vibrent dans nos mémoires attendant le jour d’être éclipsés par les merveilles des terres inconnues. Désir de fuite, d’aventure, de savoir, de richesse : nous voilà entre deux terres. Mais plus le voyage avance, plus les îles, les contrées, les continents à venir semblent s’éloigner, toujours invisibles derrière la ligne d’horizon. Pourtant la mer, au départ, certes hostile et délicate à traverser, ne devait être qu’un pont, une transition pour passer du connu à l’inconnu. Et si nous ne trouvions rien, si ce périple ne nous menait nulle part, si le voyage en somme n’avait d’autre destination que l’utopie ».
II
Voilà comment nous, habitants des terres fermes, pourrions imaginer les grandes traversées vers les mondes inconnus, entrevoir ce moment d’après départ, quand la vérité du voyage entrepris apparaît dans l’improbabilité du retour, quand les hommes assument à travers les dangers et les détours la possibilité de ne pas revenir. Mais quand bien même nous jetterions tous nos efforts au loin pour visualiser cette mer d’où toute terre a disparu, nos visions ancrées sur le rivage resteraient incomplètes. Seul le récit des navigateurs, une fois le retour accompli, peut rétablir cette communication rompue entre terre et mer. Comment alors, dans l’assurance d’avoir traversé et surmonté les épreuves de la mer, les voyageurs peuvent-ils faire sentir l’incertitude qui était la leur avant de revenir au port ? Nous ne pénétrons l’énigme de leurs épreuves qu’à travers les mots qu’ils veulent bien nous confier : récits d’aventure, mémoires d’expéditions ou carnets de bord. Quelle vérité accorder à leurs récits puisque le lieu même de leurs épreuves nous est refusé ? Peut-on opposer la solide mémoire de la terre, portant trace des moindres événements, à l’inconsistance de la mer ? Comment, en un mot, les jours sombres de leur traversée peuvent-ils être accueillis sur les rives de la terre ?
À quatre siècles de distance, un homme, Amerigo Vespucci, un des grands navigateurs de la Renaissance, un dont le prénom orne encore aujourd’hui les terres d’extrême-occident, nous répond : « Ce que nous avons vraiment supporté dans cette immensité de la mer, les risques de naufrages, les souffrances physiques sans nombre, les angoisses permanentes qui affligèrent nos âmes, tout cela, je le laisse à l’appréciation de tous ceux qui ont eu l’expérience de ces choses, et qui savent ce que signifie la quête de ce qui est incertain, et même inconnu » [1].
Réponse un peu courte sans doute que ce fragment issu du texte Le nouveau Monde, qui fut publié en 1504 et qui relate le voyage de ce même Vespucci effectué en 1501 et 1502 vers ce qui deviendra le Brésil. Réponse, pourtant, à la mesure de ce qu’il écrira sur cette traversée : il n’en dira pas plus ou si peu. Bien sûr, les indications géographiques sur le trajet emprunté par les vaisseaux ne manquent pas dans la relation : les escales, les vents qui les ont portés sont bien au rendez-vous. Ces moments où les rivages familiers sont derrière soi, où aucune terre encore ne se profile à l’horizon, sont quant à eux, sans être passés sous silence, délaissés par le récit au profit des contrées, peuples, faunes et flores des terres inconnues. Quoi de plus logique quand on découvre une terre nouvelle que de laisser les mots se répandre sur ce panorama neuf pour en faire ressortir toutes les merveilles ? Quoi de plus élémentaire, aussi, que de s’entêter en demandant encore : qu’ont-ils pu traverser ces hommes, sur ces eaux inconnues, qui reçoit tant de discrétion ? Quelle est cette gravité qui résonne dans leurs propos et qui ne semble pas s’être effacée sur le retour ? Quel est ce drame que la mer accuse de sa violence et que les marins confrontés à l’incertain ont, eux seuls, en partage ?
III
Si Vespucci en dit peu, il est pourtant clair à la lumière de ses propos que de tels voyages en mer se distinguent par les souffrances qu’ils occasionnent. Comment donc expliquer cette brièveté, cette manière d’insister sans trop en dire, sur la violence que subissent les hommes en prise avec les éléments ?
Cette retenue pourrait être l’indice d’un art de la conversation très usité à la Renaissance. Il convenait, en effet, en usant de la parole ou de l’écriture, de ne pas alourdir les histoires, les récits, par trop de détails inconnus de l’auditeur ou du lecteur. Parler était au fond, une conversation entre gens de goût, autrement dit un art de la table, et le savoir une nourriture devant être servie sans trop alourdir l’estomac, c’est-à-dire la mémoire du convive. Or, justement, le destinataire du texte de Vespucci n’était autre que son protecteur, Francesco Di Medicis, notable de Florence. Et pour donner et garder au savoir son caractère savoureux, afin qu’il puisse être dégusté par son hôte, entendu et lu avec tout le plaisir qu’il convient, il fallait que Vespucci veille, par la maîtrise des lettres, à relater son voyage avec une certaine légèreté, selon une économie calculée. C’est pourquoi, en commençant sa lettre, il précisera s’être « contenté d’exposer les choses principales les plus dignes d’être notées et retenues » [2] (afin de transformer un langage qui pût paraître grossier en un discours raffiné).
S’épancher dans une relation de voyage sur les tourments que la mer vous a réservés aurait donc été une longueur indélicate, pesante, pour les oreilles distinguées d’un notable prêt à se divertir. Cela aurait été-t-il le cas si Vespucci avait raconté son périple à d’autres marins, dans une taverne quelconque du port de Lisbonne ? Sans doute pas. Et ce non pas en raison d’une quelconque vulgarité qui serait attachée à ces lieux mais pour la propension des marins à inventer des récits d’aventure, récits dans lesquels la surabondance de périls est une occasion de glorification et de bravade plutôt que de mutisme. Mais là encore, quand bien même chaque coup du sort – tout ce que Vespucci ne dit pas – serait conté avec le plus grand réalisme, il n’est pas sûr que ses paroles auraient été comprises de tous les marins et notamment de ceux qui suivent les circuits maritimes de la pêche, du commerce et de la guerre. Ces voyages ont un but, ont un terme. Or, les voyages de découverte sont plus qu’une folle aventure, on ne sait même pas avec eux si quelque chose viendra à notre rencontre.
Ainsi Vespucci retranche de son discours bien plus que les difficultés qu’oppose la haute mer aux navigateurs, son silence relatif laisse entendre qu’une différence insoupçonnée apparaît quand l’aventure se fait vers et pour l’inconnu. Et rien ne semble lui garantir que tous les hommes qui ont poursuivi ce but l’auront forcément comprise. Qu’a-t-il donc « vraiment supporté dans cette immensité de la mer » [3]. Quelle est donc cette douloureuse vérité qui apparaît aux hommes quand le voyage en mer devient une quête de l’inconnu ? L’incertitude du but colore-t-elle différemment l’ordinaire des événements que subissent les marins ? Ont-ils vécu des choses que les voyages moins audacieux ne connaissent pas ? Nous voilà jetés dans l’embarras.
IV
Dangers, souffrances, angoisses, voilà en peu de mots nommées les traces du voyage, c’est-à-dire les voies par lesquelles il a fallu passer et les marques que l’on garde malgré soi après le retour. Ces péripéties, qu’elles se soient réalisées dans les corps et les âmes ou qu’elles les aient affaiblis de leurs menaces, sont toutes de l’ordre du malheur. Ces maux rapidement nommés épuisent-ils ce moment crucial de la traversée, quand les hommes insensiblement passent dans l’inconnu, ou bien n’en représentent-ils qu’une partie ? Faut-il imaginer bien d’autres cruautés de la part des éléments, allonger la liste des supplices? Et pour s’arrêter où ? Enfin, n’y a-t-il vraiment aucune place à la joie dans ces moments rares ?
Vespucci sans émettre de jugement sur son expérience précise les dimensions du lieu où elle doit être appréciée : ni la terre découverte, ni même celle du retour mais la mer et son immensité. L’Océan, cette vaste étendue, devient donc la mesure même de la vérité du voyage, l’aune à partir de laquelle celle-ci devra et pourra être jugée. Doit-on en conclure que le nombre des maux endurés se trouve proportionné à l’étendue des eaux ? Ces « risques de naufrages », ces « souffrances sans nombre », ces « angoisses permanentes » résumeraient-ils l’existence de maux innombrables et pour cela presque impossibles à dire ? La mer prendrait alors la forme d’une gigantesque et monstrueuse réserve de malheur, une source quasi intarissable de mal, créatrice de tourments inimaginables pour les hommes restés à terre. On verrait, sans doute, s’avancer à la surface des eaux l’ombre des enfers ou peut-être la mer et ses profondeurs abyssales serait-elle devenue la véritable incarnation de l’enfer sur terre ? Vespucci nous laisse ici sans réelle possibilité de jugement. Malgré tout, et quels que soient leur nombre, ces fléaux restent encore calculables et exprimables, comme en témoignent les détails supplémentaires que Vespucci livre à son protecteur : « En un mot, pour raconter brièvement tout cela, sache que sur les 67 jours de notre navigation, pendant 44, il y eut sans arrêt de la pluie, du tonnerre et des éclairs et une obscurité telle, que nous n’eûmes jamais une journée avec du soleil ni une nuit sereine. A cause de tout cela, nous fûmes en proie à une si grande épouvante que nous avions perdu presque tout espoir de survivre » [4]. Évidemment, le déferlement de malheurs compte dans l’expérience des hommes mais pas autant que leur affolement devant le déluge ininterrompu de calamités. Face à un tel phénomène, on ne peut qu’imaginer la vision de cauchemar qui monte parmi les marins : les éléments semblent leur dire qu’ils ne cesseront de les tourmenter, qu’ils s’abattront sur eux sans discontinuer. L’Océan, pourtant, ne réserve probablement pas plus d’infortunes que la terre. Simplement, au milieu des eaux, les événements ordinaires du monde semblent prendre des proportions fantastiques, comme si l’ordre naturel du monde, sans s’effondrer, se troublait par endroits. Par sa monotonie, son long étalement indifférent à la précipitation des hommes ou par ses accès de fureur, ses orages ravageurs, l’Océan, de moyen terme qu’il était entre deux terres, fait naître la fiction d’un milieu dépourvu de limite.
Aussi, cette vérité du voyage que Vespucci murmure entre deux mots ressemble moins à une constatation objective, une suite de faits patents que l’on pourrait partager qu’au produit d’une perspective irréelle, attachée à un moment et un lieu. Perdus au milieu de l’infini, les hommes découvraient peut-être quelque chose comme un rapport insoupçonné entre l’espace et le malheur : la possibilité soudain crédible, pourtant invraisemblable, qu’il n’y ait en ce monde pas de limite au malheur mais une interminable succession de souffrances. On comprend alors qu’au « milieu de vraiment si terribles tempêtes de la mer et du ciel » le navigateur rappelle qu’il « plut au Très Haut de [leur] montrer le continent, de nouveaux pays et un autre monde inconnu » [5]. Car devant un tel cataclysme, seul un dieu semblait encore pouvoir mettre un terme à la furie de l’Océan. Seulement, au lieu de tempérer, de modérer le déchaînement des éléments, il leur redonna espoir en faisant paraître un continent au-delà de l’horizon ; comme s’il avait lui-même reculé devant le soulèvement des mers, déserté la profondeur de leurs flots, comme si son seul pouvoir de consolation face à l’Océan était de promettre un rivage comme terre de salut.

Ivan Aivazovsky, Chaos, Création du monde, 1841, Musée de congrégation arménienne des Mhitaristes, Venise, Italie
Les découvertes accomplies dans la quête du nouveau monde ne sauraient se réduire aux terres rencontrées. Ces longues journées sans soleil, ces nuits de terreur sur l’Océan ont été sans doute la première découverte du nouveau Monde, un monde inachevé, à la fois sans limites apparentes et perpétuellement tourmenté. Des pensées étranges, des spectacles fantastiques se sont emparés des hommes durant la traversée, dévoilant un monde terrifiant : un monde sans Dieu, rebelle aux espoirs et consolations des hommes, un univers où le malheur ne promettrait aucun salut, aucune délivrance. Et probablement plus que l’impuissance des mots à rapporter tous les malheurs qui les ont accablés, le ton laconique de Vespucci trahirait l’angoisse d’avoir vu même les choses les plus certaines, comme Dieu et le Monde, vaciller sur elles-mêmes.
V
Nous avons jusque là tenté de cerner, dans le demi-silence de Vespucci, la démesure, l’excès propre aux innombrables et interminables fléaux qu’abritent les étendues inconnues de l’Océan. La traversée prépare encore d’autres drames. Car, si un écart subsiste entre la vérité du voyage et les souffrances énumérées ; si Vespucci ne dit pas tout, il nous révèle tout de même que l’expérience s’est accomplie dans les parages de l’insupportable. Les terreurs de l’interminable n’éclairent pas encore suffisamment les épreuves malheureuses des marins, d’autres événements restés muets les ont probablement assaillis. Et si ce n’était pas en raison de leur chiffre, ni de leur manteau d’éternité mais de leur puissance et du domaine où ils font rage ? Ne peut-on pas imaginer quelque chose de pire qu’un naufrage, que l’incertitude du retour ou l’attente inquiète d’une terre derrière l’horizon ? Cette vérité que nous cherchons pourrait être donnée par la rencontre d’une infortune suprême, d’une mésaventure qui surplomberait les autres en démultipliant leur gravité.
Prenons à témoin, devant le silence de Vespucci, un officier russe anonyme, juste avant le naufrage de son navire, le Saint-Pierre, près de l’Alaska, en 1741 :
« Les nuits devenaient toujours plus longues & plus obscures, & par là même le danger plus éminent, parce qu’à tout moment on avait le naufrage à craindre. En même tems l’eau douce allait manquer tout-à-fait. Le travail excessif devient insupportable au peu d’hommes qui restaient encore sur pied ; ils criaient à l’impossible, lorsqu’on les sommait de faire leur devoir. La mort qui leur paraissait inévitable tardait trop à leur gré de venir les délivrer de leurs maux » [6].
Comme dans le bref récit de Vespucci, les éléments se déchaînent ou viennent à manquer, défaut et excès, et en s’abattant sur les hommes, décuplent leur malheur. Seulement, cette fois, les marins crient à l’impossible, montrant et réclamant à la fois la fin de l’odyssée. Un vacarme remplace les prières et les plaintes rendant brutalement audible ce que la discrétion de Vespucci laissait difficilement entendre auparavant : la multiplicité et l’ininterruption des maux effraient bien les hommes mais leur convergence imprévisible, brusque ou lente les délivre également. Au XVIe comme au XVIIIe siècle, la mer voit indéfiniment revenir la même fatalité, les infortunes se conjuguent, conspirent entre elles pour former un mélange indivisible que les hommes ne pensent pas pouvoir surmonter. Dès lors, dans ces instants où la vie tourne en survie, la mort, l’extrémité des souffrances apparaît comme une libération. Déjà, Vespucci, dans son bref récit, nous rappelait combien lui et ses compagnons avaient perdu l’espoir de survivre, comment la mort était devenue pour eux quasi certaine juste avant la découverte d’une terre. Pourquoi alors n’en avoir rien dit ? Il est possible, après tout, que les hommes du rang de Vespucci, pilotes ou commandants, se faisaient un honneur de ne pas douter du succès de leur entreprise, de ne pas sombrer totalement dans le désespoir. L’attente et l’acceptation de la fin étaient peut-être laissées au marins comme un signe de faiblesse. Impossible, pourtant, de croire longtemps à cette répartition sociale du courage quand on écoute ce même officier russe reconnaître à son tour la situation extrême qui était la leur : « je ne sais s’il y a une situation plus disgracieuse au monde, que celle de naviguer par une mer inconnue. Je parle d’expérience, & je puis dire avec vérité, que pendant les cinq mois qu’à duré ce voyage, j’ai eu peu d’heures d’un sommeil tranquille, sans cesse en danger & en souci, dans des contrées ignorées jusques-là » [7].
Comme Vespucci, pressé de célébrer son Dieu de les avoir sauvés du vide terrifiant de l’Océan, cet officier ne peut tout à fait croire et nous faire croire à sa rencontre avec l’extrémité de la détresse humaine. Son récit peut attester des dangers, de la vigilance incessante et fiévreuse ; il ne peut soutenir la réalité, la vérité qui s’est annoncée au croisement des extrêmes du monde et de l’expérience humaine. Seuls les marins, finalement, ont le courage de dire, par leur sombre lucidité, éclipsant tout rêve de gloire dorée, quel rapport impossible se noue entre la vie et la mort aux limites du monde. La mort n’est plus cet accident extérieur qui anéantit la vie. Là où la vie devient insupportable, la mort s’enracine dans la vie comme le pouvoir, accepté par les uns, repoussé par les autres, d’échapper à la fatalité qu’impose l’Océan. Les hommes parviennent à l’état de survie. Cet état ne simule pas la vie proche de son degré zéro, séparée du trépas d’un dernier souffle, il dévoile aux vivants que la mort ne peut être l’extrémité de la vie, la mer finissant de les convaincre en leur réservant le pire.
Passé ce point extrême du voyage, les récits des hommes qui rentreront ne seront que des histoires de survivants. La gravité qui passe dans les paroles de Vespucci trouverait peut-être là un autre point d’ancrage. Cette façon de montrer et de pourtant retenir ce qu’il ne peut avoir oublié symbolise sans doute, aussi, le sort des hommes disparus, sans tombe, sans trace sur la terre, pudeur pour les proches restés à terre qui n’ont pas connu la joie promise du retour.

Ivan Aivazovsky, Tempête, 1854, Musée de Russie, Saint Petersbourg, Russie
Mais ce n’est pas à ceux-là que Vespucci s’adresse, il commémore bien plus avec ces marins qui comme lui ont traversé l’insupportable. Frôler la mort ou perdre la vie, c’est déjà quelque chose à raconter mais savoir qu’il y a un au-delà de la mort et qu’il ne ressemble en rien au paradis, cela reste en travers de la gorge, et pour les gens raffinés un mets difficile à avaler.
VI
Qu’avons-nous fait, nous qui connaissons si peu la mer et pourtant soucieux de dire ce que la terre ne peut savoir, sinon tenter d’être le destinataire des paroles de Vespucci ? Nous avons donc pris, pour passer au-delà de ses paroles, le manteau déjà usé d’un autre voyageur en quête d’inconnu, celui de l’utopie. Seulement pour le revêtir, fallait-il rester sourd aux opinions réduisant les utopies à des voyages et des mondes imaginaires, car elles ne prennent pas leur source dans un univers radieux et libre d’images dont chaque homme pourrait à sa guise disposer pour peindre une terre inconnue. Les utopies naissent près de ces lieux négatifs dans lesquels on ne peut séjourner mais que l’on peut seulement traverser ; elles parlent d’événements impalpables, de choses impossibles qui apparaissent et qui disparaissent aussi rapidement que des vagues mourant dans l’écume. Les paysages utopiques tirent leur pouvoir d’évocation de l’impuissance des choses à se défaire de leur état forcé de fantaisie ou de mirage, ils s’éclairent par ces choses enchaînées à la surface du monde qui ne peuvent acquérir la fermeté et la dureté de la terre, la solidité d’un fait qui les rendrait digne d’être racontées. Le masque de l’utopie était alors précieux pour décrire les épreuves que les marins ont traversées dans leur quête océanique : un monde terrifiant qui perd ses amarres, ne ressemblant plus tout à fait à l’ancien sans prendre encore la figure d’un espace habitable et humain ; l’extrême et l’interminable, la terreur et la survie, l’effacement passager de la transcendance de Dieu et de la Mort, autant de phénomènes incroyables qui peuvent être difficilement déplacés, racontés hors du lieu où ils sont apparus.

Ivan Aivazovsky, La mer noire la nuit, Musée d’Odessa, Ukraine
Voilà pourquoi, c’est peut-être finalement la mer en personne qui murmure au creux des paroles de Vespucci, une mer qui retient les hommes et les paroles comme si le langage prenait sa source dans ses flots, comme s’il n’était pas lui-même revenu sur terre, qu’une partie de lui s’était abîmé dans la profondeur des océans. Le langage de la mer ou des vagues de silence qui s’échouent sur les rivages de la terre.
Notes :
1. Vespucci Amerigo, « Mundus Novus », 1504, publié dans Le nouveau monde, les voyages d’Amerigo Vespucci (1497- 1504), Mars 2005, Éditions Chandeigne, p. 135. Retour au texte
2. ibid, p. 134. Retour au texte
3. ibid, p. 135. Retour au texte
4. ibid, p. 135. Retour au texte
5. ibid, p. 135. Retour au texte
6. Histoire des naufrages ou recueil des relations les plus intéressantes des Naufrages, Hivernements, Délaissements, Incendies, Famines & autres événements funestes sur Mer ; qui ont été publiées depuis le quinzième siècle jusqu’à présent, Librarie Cuchet, 1789, Vol III, p. 274. Retour au texte
7. ibid, p. 270. Retour au texte
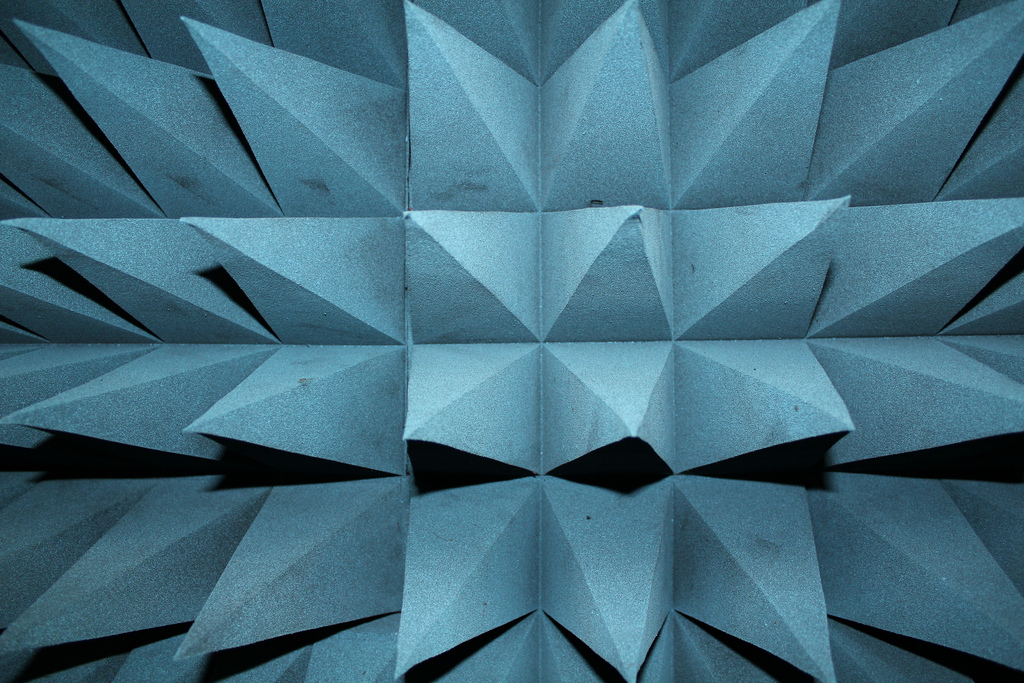 Depuis quand cela nous est-il clamé aux oreilles que nous y sommes − ou presque −, qu’il n’y aura bientôt plus rien de sauvage sur cette planète ? Que le nombre des espèces diminue chaque jour, que l’étendue et la richesse des espaces ouverts décroissent, que les populations se rassemblent, se concentrent et s’étendent en bidonvilles toujours plus nombreux, que les compagnies dévastent sols et sous-sols sous les pleins feux du soleil et qu’enfin, dans le dérisoire cloisonnement de leurs parcs, les États protègent les derniers îlots de nature ? Le temps arrive, prochain, où il n’y aura plus d’expérience possible de la sauvagerie ; plus aucune forêt, réelle ou symbolique, où nous pourrions nous réfugier, nous libérer, nous isoler, nous égarer ou nous faire face. Tout subira et accomplira le destin de l’Occident : se tourner vers où le soleil se couche, décliner vers la nuit et disparaître.
Depuis quand cela nous est-il clamé aux oreilles que nous y sommes − ou presque −, qu’il n’y aura bientôt plus rien de sauvage sur cette planète ? Que le nombre des espèces diminue chaque jour, que l’étendue et la richesse des espaces ouverts décroissent, que les populations se rassemblent, se concentrent et s’étendent en bidonvilles toujours plus nombreux, que les compagnies dévastent sols et sous-sols sous les pleins feux du soleil et qu’enfin, dans le dérisoire cloisonnement de leurs parcs, les États protègent les derniers îlots de nature ? Le temps arrive, prochain, où il n’y aura plus d’expérience possible de la sauvagerie ; plus aucune forêt, réelle ou symbolique, où nous pourrions nous réfugier, nous libérer, nous isoler, nous égarer ou nous faire face. Tout subira et accomplira le destin de l’Occident : se tourner vers où le soleil se couche, décliner vers la nuit et disparaître. 






