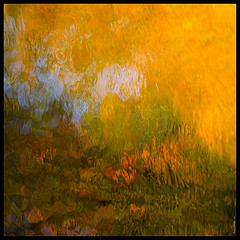Connaissances ignées
Sur le sol, charbons et cendres, pierres rougies, ossements carbonisés.
L’homme fouisseur, décolleur de rêves brunis, déchiffre dans ces marques, la trace d’un feu.
Minérales braises.
*
Yves Coppens : « La paléontologie est une science naturelle, à la fois science de la Vie et science de la Terre. Elle est donc très rigoureuse dans ses fonctions d’observations directes et comparées, comme toutes les autres sciences naturelles ; mais, de par la nature fragmentaire de son information, elle a en plus l’extraordinaire devoir d’imaginer. Or, elle a beau s’appuyer sur les données disponibles, s’aider des approches des disciplines voisines, lorsqu’il lui faut raconter, la part qu’elle emprunte à l’hypothèse est immense. Et même lorsque les fossiles sont légion, il lui faut s’évader pour remonter un paysage, y rétablir le temps et la température, y planter les lacs et les cours d’eau, y lâcher les êtres qui y vivaient dans leur forme souvent étrange. Ce n’est donc pas un de ses moindres attraits que d’être une science qui se doit de rêver pour comprendre. C’est peut-être d’ailleurs cette importance de l’imaginaire qui fait qu’elle fascine. »
D’hypothèses on parle encore, quand au moment de décrire lacs, collines, forêts et saisons, la démonstration s’est déjà dédoublée : rêves exacts et thèses approchantes.
*
Des cendres réparties dans l’orbite accidentée d’un centre désormais invisible, cercles élimés qui pourtant signent la griffe d’une main hominienne.
Des éclats d’os et de pierre calcinés, égarés dans le même entresol qu’un incendie sillonne encore à travers les âges. Accident domestique d’un feu mal contenu, passage trivial et meurtrier d’un sinistre antédiluvien ? Fossiles contigus qui de l’origine du feu ne disent rien.
Hors de la spatialisation du feu en foyer, l’origine des cendres ne peut, sans marge d’erreur importante, être assignée. Hors du foyer, la présence de l’homme aussitôt se confond avec celle de l’incendie.
*
Les témoignages incontestables de foyers organisés, apparaissent seulement, entre 300 000 et 250 000 ans avant notre ère. L’hypothèse survit d’un usage du feu dès l’Homo Habilis, il y a environ deux millions d’années – ou Homo Erectus entre 1,7 et 0,5 millions d’années. Ces êtres, Habilis et Erectus, appartiennent au genre Homo mais pas à l’espèce humaine. User du feu ne distingue aucune humanité ; fonder un foyer n’institue aucun progrès, ni passage d’une espèce à l’autre.
Pourtant, de l’incendie au foyer, notre espèce a fait circuler maintes espérances.
Homo sap(i)ens
Entre l’Homo Erectus et l’Homo Sapiens, la sociabilité s’est considérablement transformée. Elle s’est intensifiée, dans la dépendance accrue du petit d’homme à sa mère ; elle s’est polarisée, dans les jeux de rivalité des mâles pour les femelles ; elle s’est élargie, dans la coopération à la chasse… puis, on ne sait quand, elle s’est figée dans le familier décor de la horde rassemblée autour du foyer.
Saper = Détruire les foyers à la base par une action progressive et secrète.
*
Le feu appartient sans doute à l’histoire des techniques, histoire qui s’est longtemps écrite de deux manières. L’une décrit les objets façonnés comme des prolongements artificiels, des projections extérieures des fonctions organiques du corps humain. Ainsi le télescope pour l’œil, le disque dur pour la mémoire, l’éprouvette comme utérus de substitution. L’autre perçoit la technique comme instrument, médiation entre les choses, modifiant la puissance du corps et sa distance au dehors. L’épée rend la main tranchante en évitant les luttes au corps à corps, le stéthoscope fait résonner l’intérieur de la poitrine au-delà du thorax en laissant l’oreille du docteur à sa nigaude pudeur.
Ces deux histoires ont parfois été confondues en une seule. Les artifices fabriqués par les hommes témoignent qu’une part de lui-même a été arrachée au site premier du corps « propre » pour être implantée dans la réalité extérieure des objets. Aussi, l’homme ne gagne-t-il pas en puissance dans le développement de la technique : à mesure que les machines, objets et instruments se perfectionnent, il perd d’autant plus de réalité et de force. L’homme s’épuise au cours du progrès.
La technique est l’enjeu d’un asservissement où les positions de maître et d’esclave, bien qu’étant réversibles, dressent toujours entre les êtres les chaînes de la domination. De là, les thèmes négatifs d’une rébellion des machines tant prisée par la science-fiction ; ou les catastrophes naturelles comme revanche de la nature dans les prophéties morales.
*
Les hominidés n’ont jamais découvert, ni maîtrisé le feu. Le feu est déjà un esclave attaché aux foyers des troupeaux d’humanisants. Il faudrait dire qu’ils ont en fait maîtrisé l’incendie. Mais cela non plus ne peut être dit car ces hordes, à l’échelle des temps historiques, sont elles-mêmes devenues un nouveau foyer d’incendie.
Par mégarde, le feu se libère et devient l’incendie qui dévaste les habitations ; par ruse, les hommes le déchaînent pour brûler les sols et mettre à sac le foyer de leurs ennemis. Les espèces humaines ont tout au plus capturé ce fauve qu’elles ont relâché aussi souvent sur la terre que ne l’ont fait les événements naturels. Les hominiens n’ont pas diminué la puissance de l’incendie mais déployé son emprise, multiplié les occasions ponctuelles de ces départs. Là où des incendies naissaient entre le ciel et la terre, dans les orages ; là où ils émergeaient des profondeurs terrestres dans les éruptions volcaniques, où ils fusaient dans le froissement des branches giflées par la violence des vents, ils ont transporté les brasiers partout où leurs yeux et leurs mains ont trouvé à se poser.
*
Pour rêver au milieu des cendres que recueille la paléontologie, il faut libérer l’incendie du feu, c’est-à-dire du maître et de l’esclave, de la machine et de la fonction.
Fulguration
Ne serait-ce que subsister ou même approcher des flammes, exige des animaux le passage d’un seuil historique, l’épreuve de la panique.
Les animaux sont volontiers perçus comme fuyant le feu, comportement le plus fréquent. Les témoignages incontestables de guépards faisant face aux flammes toutes proches n’infirment pas la généralité de cette réaction. Simplement, l’esquive du feu n’apparaît plus aussi universelle mais habituelle seulement. Les bipèdes, en s’approchant du feu, n’ont pas accompli de révolution morale ou éthologique parmi les mammifères supérieurs, ils ont simplement suivi puis régularisé une improbable inclination : habiter près du feu.
La question demeure. Pourquoi l’Homo Habilis, ou même les australopithèques, auraient-ils cessé de fuir pour s’emparer du feu ?
*
Dans l’impuissance à voir ce qui arrive – je ferme les yeux devant le danger – la peur appréhende, même et surtout dans la fuite, l’événement qui menace. Tourner le dos, fermer les yeux : répandre la nuit autour de soi, opposer les ténèbres à cette présence grondante qui ne vient pas. Invisible péril.
L’épouvante peuple cette nuit de faciès informes, d’effigies aux traits hésitants, figures dérobées à l’aveuglement. On ne détourne pas les yeux du danger parce qu’on a peur, on va chercher dans la cécité passagère de quoi saisir la menace encore sans visage.
Bientôt nous verrons ou nous serons : une bête noire ouvrant sa gueule, pour hurler, ou pour mordre.
*
Nombreux récits de science où les orages foudroient les singes humains de terreur jusqu’au matin où, au milieu de silhouettes courbées, se sont levées de pleines statures d’homme.
Le passage à la station debout est un des vecteurs décisifs dans l’évolution des hominidés. Expérience anatomique, ce coup de tonnerre fut et reste le véhicule de valeurs anthropologiques, même au sein de la science la plus dure. Debout, dressés contre et devant leur peur.
*
Le rire est l’éclair foudroyant qui rebondit sur l’homme fier qui montre sa bravoure une fois seulement l’orage passé ;
le rire est la bravade lancée envers l’homme qui bouche ses oreilles dans l’amorce du grand fracas ;
le rire est le tonnerre jeté à ceux qui tremblent d’effroi ;
le rire est un appel à suivre ces flammes qui s’amoncellent au loin, loin de nos pas.
*
Derrière l’éclair où perce la gueule demi-ouverte des Simiesques, aucun tonnerre ne vint. Fulguration d’où les hominidés surgirent pour répondre à l’orage d’une grimace nouvelle, en fait d’un rire hautain.
*
Le ciel et la terre s’enhardissent et viennent à peser l’un sur l’autre :
les nuages se bousculent et s’amoncellent,
les arbustes clairsemés des steppes agonisent,
un événement mythique et absolument ordinaire se prépare.
Devant cette colonne lumineuse qui court au loin, quelques secondes, avant de disparaître, une décharge de peur lézarde la face encore projetée de quelques hominidés. Un irritant frisson traverse le trou occipital. La gueule demi-ouverte, ils se redressent dans l’attente.
L’incendie enfin paraît. Non loin, consommant le jour déjà mûr, une épaisse fumée noire colore le ciel dégagé.
Un bosquet tailladé par la foudre
Des arbres solitaires et nus
Aux écorces durcies et fendues
Dépècent des bouquets de feu.
Les bipèdes s’approchent, cherchant les branches des yeux, cueillant les torches d’une main.
Feu de brousse
Peu après l’aube, le brasier échangea son pelage blanc contre les puissants rougeoiements du soleil. L’avancée de l’incendie creusait les sillons de l’aurore à même la terre. Bientôt, l’horizon serait borné par un mur de flammes.
Des essaims de buffles, d’antilopes et de girafes qui n’avaient pu fuir, suffoquaient, à l’abri encore de la morsure des flammes, dans le dessèchement irrespirable d’un coin de savane. Plusieurs se jetèrent dans le flamboiement âcre des arbustes, dernier souffle végétal s’élevant bien plus haut que leur garrot, pour s’écrouler plus loin au bout de quelques mèches grises de carbone brûlant ; quelques-uns franchirent les rares affaissements du cercle, roue ardente et mobile, pour retrouver les herbes rases de la savane sinistrée.
Des hominiens étaient là aussi cette nuit, réveillés par les troupeaux affolés. Dressés mais immobiles dans le sol qui grondait, les aiguilles de chaleur qui fleurissaient dans l’air commençaient juste à perforer leurs poumons. Le tumulte des troupeaux soulevait une poussière presque palpable, piquant leurs narines de son arôme térébrant. Ils voyaient fauves et herbivores partager la même piste folle, rompre toute hiérarchie parmi leurs clans, abdiquant toute hostilité naturelle. Tous fuyaient la puanteur du jour naissant, chair et pâture consumées derrière eux.
Beaucoup d’hommes écœurés les suivirent, certains sont encore là au milieu des cendres amoncelées. De longues heures solitaires, égarés, ils se sont rassemblés par grappes autour du bétail agonisant. Sous le soleil qui décline, leurs faces brûlées rongent avec ardeur la chair roussie des cadavres fumants. Cette nuit, la lune saluera la naissance d’un nouveau carnassier.
*
La peur est détournement du regard sur sa propre disparition, détournement qui achève la puissance de l’imperceptible danger qui survient par derrière. La peur, attente de la mort acceptée. Distincte de l’effroi et sa relation médusée qui vous laisse dévorés, fascinés par les flammes ; peur qui accepte le regard aussitôt invisible du meurtrier.
La plupart des animaux fuient les incendies, effrayés. Ils savent d’instinct sans avoir subi la morsure du feu qu’il faut éviter sa présence. Ils réagissent face au danger prévisible. Frayeur et terreur des proies, fuite devant la dévoration de l’espace, fermeture du champ vital. Seuls quelques prédateurs, parmi lesquels certains hominidés, perdent leur instinct de proie et perçoivent l’incendie comme un chasseur occasionnel, aux courses imprévisibles, un prédateur plus puissant dont il faut se méfier mais dont on peut dévorer les restes.
Ces prédateurs ont appris à se terrer, à se frayer une issue vitale dans les flammes. Guidés par le goût de la charogne brûlée.
*
Le foyer ne vient pas après l’incendie, il lui est contemporain. L’incendie dépose dans son sillage des braises, cadavres roussis. Spontanément, l’espace sinistré se peuple de foyers.
Comment les hommes sont-ils passés de l’installation passagère dans les méandres étouffés de l’incendie pour suivre et saisir les victimes qu’il abandonne, à l’implantation sédentaire du feu encerclé dans un foyer ?
Le foyer à sa source naît où l’incendie laisse un buffle, une antilope, cramés. Les hominidés découvrent le feu à la surface des chairs. Il y a bien découverte du feu par les hommes quand l’incendie se révèle de lui-même, fumant, au-dessus de l’horizon.
Le passage de l’incendie au foyer ne s’accomplit pas par une maîtrise du feu, ni même de l’incendie, mais par une transformation du comportement, un passage de la fuite à la frayeur. L’homme n’a plus fui devant le feu en s’exilant loin des espaces que l’incendie dévore : airs et sols, bouches et gueules, fétides et brûlantes. Il s’est jeté dans la gueule des flammes et s’est nourri dans leur puissant foyer. La frayeur animale a changé de sens. L’homme s’est avancé vers l’incendie et l’a suivi pour repérer à chaque fois un foyer nourricier.
*
Contre les prédateurs qui eux aussi reniflaient les charognes roussies, les espèces humaines laissèrent la proie se consumer. Se carboniser. Devenu inconsommable, le cadavre brûlant devint le piège de l’incendie. Sous chaque foyer gisent les braises d’une dépouille calcinée.
Garde nocturne
De nombreux anthropologues estiment que les hominidés ont probablement usé du feu pour mettre à distance les fauves.
*
Aucun soleil ne vient nous accompagner au-delà du crépuscule
Si bien que les bêtes rôdent aux abords de la clairière,
Chaque nuit, derrière soi, le long de l’échine et par la nuque,
La terreur atteint la pulpe de notre cerveau lézardé.
Au fond des yeux, sur les parois du crâne, grincent les griffes pleines, chaudes et tranchantes des fauves.
Nos rêves alors s’obstinent cauchemars :
Des fragments de course sans mobile, des libérations sans issue, des cris sans écho, des pupilles sans regard ;
Ouvrir les yeux ne délivre de rien, aucune lumière apaisante ne règne au dehors.
Seule une buissonnière lune éclaire, colore parfois nos gestes aveugles et maladroits.
Le sommeil n’existe pas tout à fait encore,
constamment traversé de veilles fulgurantes,
de songes opaques.
Les rythmes de garde et d’échappée se relaient comme des saisons bousculées.
*
« Puis la fatigue nous a amené le rêve. Ces rêves qui figuraient l’aurore pointant ses larmes sur nous, qui nous réconciliaient avec la terre. Les rêves dans les délires de la fatigue et de la peur, exfiltraient les scintillements des étoiles derrière la frontière presque close de nos paupières tombées. Par le feu, nous trouvâmes un veilleur et nous gardions nos rêves. La meute s’assoupit alors dans l’imprudence heureuse. »
*
La torche, incendie encerclé et affamé dans la digestion lente d’une graisse, d’une essence. La torche dans la nuit ne se substitue pas au soleil, le feu ne conduit pas les hommes aveuglés dans l’obscurité, le feu est une lune pleine, rousse et sournoise.
*
Les hominidés rassemblés autour du foyer digèrent les fauves qui leur brûlent l’estomac.
Imagier bibliographique
Bachelard Gaston, La psychanalyse du feu, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1985.
Coppens Yves, Le singe, l’Afrique et l’homme, Paris, Fayard, 1983, p. 12-13.
Leakey Richard, L’origine de l’humanité, Paris, Hachette Littératures, coll. « Pluriel », 1997.