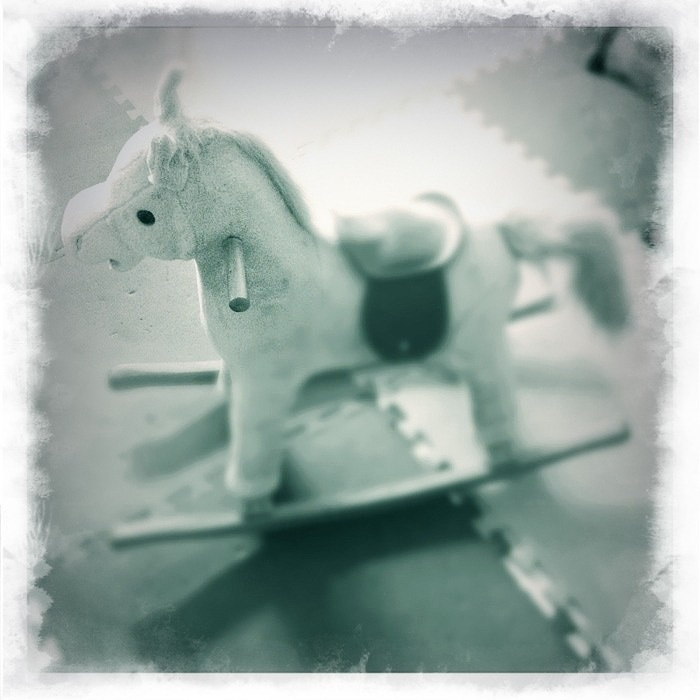Aurions-nous à savoir ce que peut bien être aujourd’hui un enfant, on pourrait imaginer le procédé suivant : recueillir, une à une, les paroles qui nous le désignent, nous le nomment, nous l’appellent, selon les évidences les plus immédiates que puisse nous donner le fer de notre intuition. Capacité d’imitation, goût pour le jeu, fragilité devant la mort et la maladie, défaut de langage, marche hasardeuse, mouvements imprécis, inachèvement du cerveau, suggestibilité, capacité à trouver du plaisir selon des voies aussi étranges que diverses… Autant de caractéristiques hétéroclites, sans âge ou étonnamment neuves, qu’il s’agirait ensuite de transformer en image, le plus simple serait peut-être un dessin, histoire d’en composer un portait même hâtivement. Pouvons-nous savoir, imaginant le résultat de tant d’évidences accumulées, à peine ordonnées sur le rectangle d’une feuille de papier, quel spectacle étrange il nous serait donné de voir ? Ne serions-nous pas profondément intrigués de pouvoir reconnaître chaque trait et de ne pas percevoir cet être que notre langage nous apprend à nommer « enfant » ? Si, continuant notre jeu, nous demandions avec malice qui des adultes ou des enfants sont les plus disposés à parler de cette expérience : la vérité ne sort-elle pas tout droit de la bouche des enfants ? Ici démarrerait peut-être une longue interrogation philosophique (sur l’être de l’enfance, sur la vérité qu’on lui accorde ou qu’on lui retire) et la dérision, aussi, qui ne manquera pas d’accompagner ce genre de questions.
Car, enfin, quel sérieux pourrait avoir une telle question portée sur l’être-enfant, là où notre culture, notre époque se distingue par la découverte enfin acquise des premières certitudes sur sa nature ? Nulle époque n’a été plus attentive, plus protectrice envers les enfants, autant de vertus à la faveur desquelles se développent sans obstacle les connaissances pédiatriques, psychologiques ou embryologiques à leur sujet. Du moins on le clame et les historiens le confirment, nous montrant comment, se défaisant des préjugés moraux et de pratiques douteuses, les pédagogues et les médecins ont peu à peu ouvert les yeux sur ce spectacle qui naguère se dissimulait sous les vaines figures de la fantaisie des hommes. Bien sûr nos propos quotidiens trahissent parfois d’antiques pensées, des manières de voir un peu passées mais ce ne sont que murmures sans lendemain devant la solidité de nos connaissances, la précision de nos observations et la sollicitude de nos diagnostics. L’enfant, comme tant d’autres choses en ce monde, a perdu ce visage hétéroclite qu’une imagination sans règle et des intuitions de bon sens lui conférait, il est en passe aujourd’hui de se refermer sur sa vérité. Notre tâche, alors, n’est plus de questionner un être énigmatique mais d’accumuler, d’organiser et d’unifier les connaissances qui permettront à l’Enfance de n’être plus une généralité abstraite mais le nom d’un objet à l’existence certaine.
Accordons cela. Notre époque est bien le lieu d’un événement singulier, celui d’un âge où l’enfance a dû reconnaître dans des savoirs aussi divers que la biologie, la pédiatrie et la psychologie, sa vérité. Notre être-enfant se dirige depuis plusieurs siècles vers un monde dans lequel le vrai et le faux, le normal et l’anormal sont les repères majeurs. Avançons-nous pour autant vers une unification du savoir sur l’enfance ? La pédagogie a bien perdu son autonomie en se subordonnant à la psychologie, la loi s’énonce maintenant sur les données du vivant et si elle s’appuie parfois sur une morale, c’est toujours en fonction d’une norme protectrice pour la santé mentale ou physique des enfants. Une homogénéisation s’opère aussi bien au niveau du savoir qu’à celui des institutions sociales, autour de cette figure centrale, majeure, presque transcendante, qu’est l’Enfance. Et pourtant, nous sentons bien qu’ici et là les différents discours sur l’enfant ne s’accordent pas, ne parlent pas de la même chose. Quelque chose résiste, qui ne laisse pas connaître, qui se réfugie parfois dans la littérature… mais non, nous avons maintenant une littérature adaptée aux enfants ! Où pouvons-nous donc entendre aujourd’hui cet enfant parler d’autre chose que de sa vérité ? La sienne et celle des adultes qui les regardent fixement ? Entre ses paroles qui nous distraient, qui nous irritent ou qui nous charment (quitte à les noyer, ensuite, dans encore plus de fabulation) et celles qui, malgré elles, nous informent de son état, de ses désirs ou ses angoisses, quel langage de poids l’enfant tient-il encore dans notre culture qui ne soit pas ordonné au partage du vrai et du faux ?
Avons-nous oublié ces âges où l’enfance nous parlait de la mort, des dieux, des rois et des bêtes merveilleuses ? Non, bien sûr, et c’est bien entendu le mérite de la psychanalyse de nous montrer encore combien ces antiques significations enveloppent toujours encore notre expérience d’être enfant. Mais là encore, ne rassemble-t-elle pas ces figures immémoriales dans la forme vide de l’illusion, du fantasme ou du roman familial ? La parole de l’enfant n’était-elle pas plus libre autrefois tandis que le destin de celui-ci se perd de plus en plus de nos jours dans les rigueurs des connaissances souveraines qui frappent de nullité toutes les expériences, toutes les manières d’être qui sont apparemment devenues étrangères à l’enfance. L’histoire elle aussi, entamée bruyamment avec Philippe Ariès, cherchait au départ à montrer combien nos vérités actuelles étaient étrangères aux siècles passées tout proches pourtant. Elle tentait de saisir la singularité de notre rapport à l’enfance là où nous la voyons universelle et certaine (avènement de la vérité de son être). Or, cette voie s’éteint lentement tant la langue des historiens de l’enfance s’est chargée de notions psychologiques. L’histoire de cette nouvelle visibilité de l’enfance est figurée par ce long mouvement au cours duquel médecins, parents, nourrices et pédagogues ont fini par reconnaître en elle les vérités actuelles de la naissance et de la prématuration, de la croissance et du développement, etc., etc.. Ainsi, le débat historiographique sur l’amour porté aux enfants s’est-il engagé à partir de notions psychanalytiques et des normes actuelles de maternité et de paternité ; l’étude si délicate des actes d’abandon, d’exposition (pensons aux tragédies et aux récits grecs) s’est perdue dans l’appréciation des désirs inconscients des parents ou dans la seule analyse de la situation économique des familles. Dès le départ pourtant, et Ariès le reconnut, l’histoire n’a pu tenir un langage neutre sur l’être de l’enfance. Mais si elle utilisait ainsi le vocabulaire d’une psychologie périmée, si spontanément l’histoire se faisait anachronique vis-à-vis de la vérité moderne de l’enfant, n’était-ce pas le signe de la voie qu’il fallait emprunter : pour de se défaire d’une certaine pensée de l’enfance et pour se préparer aussi à accueillir pour elle d’autres langages ?
Bon nombre d’expériences hétérogènes à la notre, qui subsistent et résistent sans doute encore, sont progressivement recouvertes par un seul et même type de savoir aux règles encore peu connues. Peu connues car il ne suffirait pas de reprendre certains thèmes comme ceux de médicalisation, de normalisation pour penser en avoir fini les problèmes en jeu dans cet événement qu’est l’avènement moderne de la connaissance de l’enfance. Je pense bien sûr à la fortune « malheureuse » des travaux de Michel Foucault, notamment dans les études de sociologie portant sur le domaine (où l’on contente bien souvent de reprendre les thèmes, si ce n’est les termes, au lieu de reprendre le travail de description, d’analyse et de comparaison ; car même si l’histoire des rapports entre raison et folie possède probablement certaines analogies avec celle par laquelle l’enfance est passée « pour » devenir un objet de connaissance, les deux sont loin d’être identiques : ici et là, les problèmes posés à la connaissance ne sont pas les mêmes, les figures de la raison auxquelles les enfants ont à faire sont différents ; et, en fin de compte, si malgré tout, les deux histoires s’avéraient similaires, ne serait-ce pas lié à la parenté que notre culture reconnaît toujours aujourd’hui entre folie et enfance ?
On supposera donc que les principes avec lesquels on établit la connaissance de l’enfant et les problèmes que celle-ci soulève en se posant, sont spécifiques. Nous l’avons déjà dit, malgré les multiples communications qui parcourent les différentes régions du savoir, le rêve positiviste d’une connaissance unifiée n’est pas encore réalisé. Les discours vrais sur l’enfance ne parlent ni de la même chose, ni de la même manière. Mais alors, de quoi parlent-ils précisément ? De quelle manière font-ils de l’enfance un objet de connaissance ? Supposons qu’un tel objet se forme par l’intermédiaire de grilles, de tables et de trames par lesquels sont sélectionnés et prélevés un certain nombre de traits appartenant aux diverses figures, statuts ou images que les groupes sociaux et les institutions donnent aux enfants. Ces trames à partir desquels les phénomènes « retenus » vont pouvoir être décrits, répartis et classés, dessinent un espace nouveau, symbolique si l’on veut, où la présence de l’enfant sera visible sous une nouvelle forme. Ce sont, par exemple, les tables de développement utilisées par les pédiatres et les psychologues, les schémas de maturation fabriqués par les embryologistes, les pyramides des âges des démographes, les cycles scolaires, les échelles d’intelligence de Binet. Ce peut être aussi des appareils, comme les bocaux dans lesquels étaient conservés les cerveaux d’enfants idiots ou les éprouvettes dans lesquelles s’effectue maintenant certaines fécondations. Ou encore, des lieux aménagés, comme la pièce remplie de jouets aux effets calculés qu’utilisait Mélanie Klein pour ses séances avec les enfants. Bref, ces schèmes qui dessinent l’espace dans lesquels certains phénomènes vont se répartir d’une nouvelle manière, selon une nouvelle visibilité, peuvent et doivent être analysés comme les conditions de l’objectivation de l’enfance.
Ces opérateurs, finement décrits dans leur structure et leur fonctionnement, permettraient de montrer en quoi les différents discours sur l’enfance communiquent et se séparent, sur quel point et à quel niveau. Ainsi, serait-il précieux de voir plus clair dans l’usage que fait la psychologie des notions de développement, de maturation quant il s’agit de phénomènes comme le désir, la mémoire, l’intelligence… On saisirait également mieux la différence entre la psychologie et la psychanalyse qui ordonne plutôt le temps de l’enfance autour d’épreuves de vérité concernant le corps propre, le sexe, la parenté et la loi. Bref, une telle description serait à même de clarifier les différentes options qui ont été prises dans notre savoir sur l’enfance quant à la détermination de sa vérité. Car, si cette volonté de vérité tend à s’affermir, il ne s’en suit pas quelle soit en son sein homogène et que ses divers chemins soient indifférents. Le lyrisme de certains spécialistes, psychologues ou médecins, sur la valeur de l’enfant, comme source d’un homme nouveau, richesse d’une nation, peut très bien s’ouvrir à des pratiques visant à protéger l’enfant mais aussi s’articuler à des entreprises eugénistes. On comprend alors qu’un tel scepticisme devant ce qu’on appelle les progrès de la connaissance ne dérive pas d’un romantisme fasciné par une époque révolue où l’enfance aurait été libre et joyeuse. Il tient plutôt, dans un souci proche de celui de Nietzsche, à scruter la valeur de ces efforts de connaissance que notre culture accueille et encourage, à en saisir les tendances et les risques et, plus difficilement, à en faire sentir tout le prix. Et si finalement, nous insistons autant sur l’existence, passée ou présente, d’expériences d’être-enfant différentes, expériences qui nous tournent le dos, c’est bien afin de préparer nôtre époque à un dialogue, à une confrontation, salutaire.