 Le problème de l’historiographie amoureuse est qu’elle suppose bien souvent comme donné ce dont elle doit pourtant montrer l’émergence. Ainsi le livre classique d’Edward Shorter, Naissance de la famille moderne, qui montre comment le relâchement du contrôle des relations pré-nuptiales, les relations de fiançailles, par les familles et la communauté va peu à peu donner lieu, chez les « jeunes gens », à un comportement expressif plutôt qu’un comportement globalement utilitaire : on s’unit alors plutôt sur le coup de l’amour qu’en vue d’un intérêt. Progressivement, une force prend le pas sur l’autre. Il suffirait donc ainsi que la pression diminue, que la vigilance tatillonne s’endorme, pour que toute une série de conduites affectives que Shorter détaille de façon précise — le désir sexuel, l’attractivité physique, la sympathie mutuelle — trouve à s’exprimer socialement. Problème : en essayant de saisir le moment où apparaît la romance amoureuse (l’historien parle en effet de romance pour qualifier ce qui est d’abord et avant tout une forme de cour et il est important de garder ce terme pour ne pas user du terme trop général d’amour : la romance est une pratique là où l’amour, en général, nous apparaît comme un simple sentiment), Shorter fait porter son regard uniquement sur les formes de sensibilité qu’il estime précéder le mariage et l’entrée dans la vie familiale et non sur leur articulation qui ordonne pourtant l’exercice de la cour amoureuse. Reprenons ensemble chacun de ces points : le désir sexuel, l’attractivité ou l’inclination physique et l’affection mutuelle.
Le problème de l’historiographie amoureuse est qu’elle suppose bien souvent comme donné ce dont elle doit pourtant montrer l’émergence. Ainsi le livre classique d’Edward Shorter, Naissance de la famille moderne, qui montre comment le relâchement du contrôle des relations pré-nuptiales, les relations de fiançailles, par les familles et la communauté va peu à peu donner lieu, chez les « jeunes gens », à un comportement expressif plutôt qu’un comportement globalement utilitaire : on s’unit alors plutôt sur le coup de l’amour qu’en vue d’un intérêt. Progressivement, une force prend le pas sur l’autre. Il suffirait donc ainsi que la pression diminue, que la vigilance tatillonne s’endorme, pour que toute une série de conduites affectives que Shorter détaille de façon précise — le désir sexuel, l’attractivité physique, la sympathie mutuelle — trouve à s’exprimer socialement. Problème : en essayant de saisir le moment où apparaît la romance amoureuse (l’historien parle en effet de romance pour qualifier ce qui est d’abord et avant tout une forme de cour et il est important de garder ce terme pour ne pas user du terme trop général d’amour : la romance est une pratique là où l’amour, en général, nous apparaît comme un simple sentiment), Shorter fait porter son regard uniquement sur les formes de sensibilité qu’il estime précéder le mariage et l’entrée dans la vie familiale et non sur leur articulation qui ordonne pourtant l’exercice de la cour amoureuse. Reprenons ensemble chacun de ces points : le désir sexuel, l’attractivité ou l’inclination physique et l’affection mutuelle.
On est trop informé aujourd’hui — à tort ou à raison peu importe — de la multitude d’objets et de voies que peut se donner le désir en matière de satisfaction et d’accomplissement pour s’imaginer que, spontanément, une fois la pression de la communauté relevée, ce dernier allait nécessairement se faire jour sur un mode hétérosexuel. Pourquoi les filles iraient forcément vers les garçons et inversement ? Et pourquoi forcément vers des gens de leur âge ? Et s’il y eût ce relâchement dont on parle (ce qui, je pense, est à reconsidérer), s’est-on vraiment posé la question, hors des gender ou des queer studies, sur le tour ou les directions qu’a pris le désir ? (Je parle sur ce point en toute innocence de cause) On voit déjà qu’entre la soi-disant expression simple d’un désir sexuel, souvent d’ailleurs fortement naturalisé, et le comportement amoureux que notre culture relève encore comme le seul, ou du moins le plus touchant, il y a un écart, une distance, un ensemble de conditions qu’il faut déterminer. Le désir sexuel ne s’exprime pas de lui-même sous la forme d’une romance amoureuse.
Si on prend ensuite le problème de l’inclination, de la préférence ou de l’attirance que je distinguerais du désir sexuel car c’est une notion (si on ne la réduit pas à la seule dimension dite physique qui ne veut pas dire grand chose tant les corps dans chaque culture ont une stature, une allure, une gestuelle toute entière physique et culturelle), une notion qui met en jeu tout une série de phénomènes comme la rencontre avec autrui, la perception et l’appréciation de soi et des autres, l’individualisation de l’aimé et la manifestation de sa préférence, phénomènes qui débordent le simple problème de la sexualité en tant que tel. J’ai beau désirer des hommes, des femmes, ou qui on veut, comment passe-t-on à telle femme et tel homme et quelles sont les implications de cette orientation non plus spécifique mais particularisée, « qualifiée » du désir. Au sein des grands découpages dans la masse des objets sexuels auxquels se livre le désir, et des directions qui s’en suivent, apparaissent des flèches, des diagonales et des cibles plus précises. C’est sans doute que la cour d’amour n’est plus une simple expression de l’inclination (comme si elle était le masque cultivé et policé d’un désir plus indifférent) mais une forme d’élaboration de cette préférence : non seulement une justification mais également une manifestation. Or, encore une fois, pourquoi les préférences plus ou moins affirmées, les inclinations d’intensité inégales, portées à tel ou tel individu, ont trouvé à s’exprimer de telle manière que non seulement leur existence dut se faire savoir mais également s’exprimer de telle manière que les autres ne le pouvaient plus — ou du moins un tel comportement ne pouvait plus être toléré. Parmi toutes les inclinations différenciées que nous vivons chaque jour vis-à-vis des personnes que nous rencontrons, et donc certaines ne donneront lieu qu’à un sourire ou un bonjour plus appuyé, pourquoi fut-il d’un coup nécessaire d’en manifester l’existence, d’en souligner les orientations et surtout d’en durcir le mouvement ? Là encore, entre le jeu des préférences et la cour d’amour toute une série de relations, d’implications et d’exclusions sont à décrire.
Enfin, la sympathie amoureuse dont on retiendra la dimension de mutualité. Enonçons le problème de manière abrupte : pourquoi la sympathie pour autrui, même doublée d’un désir sexuel ou d’une inclination reconnue pour cette personne, doit-elle être partagée, réciproque ? Pourquoi ce fameux nouvel amour, à l’inverse de l’amour courtois par exemple (du moins tel que mes souvenirs de lecture me le font imaginer), doit-il être réciproque au lieu de n’habiter qu’un seul des protagonistes ? C’est là que ces trois petits termes que liste Shorter, même s’ils se les donnent tout fait, comme n’attendant qu’un comportement acceptable et acceptée pour se montrer, témoigne tout de même de l’excellence du regard de l’historien. Car c’est bien cette réciprocité sensible qui qualifie l’aventure amoureuse contemporaine. Oui, on frémit bien de voir ce sentiment resté si longtemps unilatéral, malgré tout le mal que se donne celui ou celle qui fait la cour; oui, on pleure de voir que parfois il échoue, que tout l’amour du monde manifesté à autrui ne suffit pas toujours à bien l’émouvoir. Mais c’est parce qu’on s’attend à ce que non seulement cette cour réussisse mais qu’elle se déclenche aussi sous la condition plus ou moins perceptible d’une réciprocité déjà installée, ou du moins naissante. L’amour tel qu’on l’entend encore aujourd’hui dans la romance qui le met en jeu et qui en constitue la pratique fondamentale se doit d’être partagée, à ses débuts et à sa fin : il ne peut sortir du cercle de la mutualité sans nous faire souffrir, du moins nous attrister.
Ce que j’aime dans le pouvoir que donne les bibliothèques, c’est d’avoir la possibilité, soudain, alors qu’une question vous crève la poitrine et qu’un flot de réponses stupides vous coule des yeux, de lire quelque chose en rapport avec votre problème et qui vous permettra de ne pas y sombrer. Trouver un livre qui puisse vous parler, ouvrir une page qui vous aidera peut-être à tourner la vôtre, voilà, en quelques lignes écrites d’une traite, ce qui vous permet de tenir dans la plus forte tourmente et vous donne le désir de le partager. Que ce je vis de l’intérieur, trop plié, trop froissé, pour que je puisse l’arracher m’apparaisse soudain comme un énorme pan de l’histoire tiré, déroulé, depuis plus longtemps que moi, et de si loin que je n’en vois pas la fin : chance, quand même, de parvenir à le déchirer.
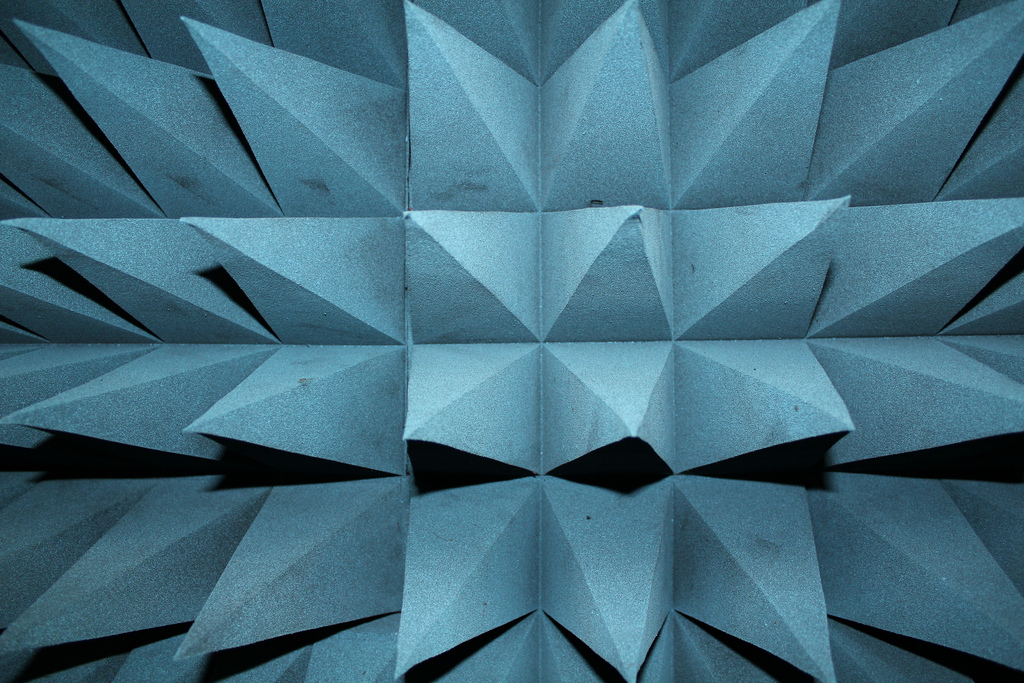 Depuis quand cela nous est-il clamé aux oreilles que nous y sommes − ou presque −, qu’il n’y aura bientôt plus rien de sauvage sur cette planète ? Que le nombre des espèces diminue chaque jour, que l’étendue et la richesse des espaces ouverts décroissent, que les populations se rassemblent, se concentrent et s’étendent en bidonvilles toujours plus nombreux, que les compagnies dévastent sols et sous-sols sous les pleins feux du soleil et qu’enfin, dans le dérisoire cloisonnement de leurs parcs, les États protègent les derniers îlots de nature ? Le temps arrive, prochain, où il n’y aura plus d’expérience possible de la sauvagerie ; plus aucune forêt, réelle ou symbolique, où nous pourrions nous réfugier, nous libérer, nous isoler, nous égarer ou nous faire face. Tout subira et accomplira le destin de l’Occident : se tourner vers où le soleil se couche, décliner vers la nuit et disparaître.
Depuis quand cela nous est-il clamé aux oreilles que nous y sommes − ou presque −, qu’il n’y aura bientôt plus rien de sauvage sur cette planète ? Que le nombre des espèces diminue chaque jour, que l’étendue et la richesse des espaces ouverts décroissent, que les populations se rassemblent, se concentrent et s’étendent en bidonvilles toujours plus nombreux, que les compagnies dévastent sols et sous-sols sous les pleins feux du soleil et qu’enfin, dans le dérisoire cloisonnement de leurs parcs, les États protègent les derniers îlots de nature ? Le temps arrive, prochain, où il n’y aura plus d’expérience possible de la sauvagerie ; plus aucune forêt, réelle ou symbolique, où nous pourrions nous réfugier, nous libérer, nous isoler, nous égarer ou nous faire face. Tout subira et accomplira le destin de l’Occident : se tourner vers où le soleil se couche, décliner vers la nuit et disparaître. Les places libres que de nombreuses villes connaissent encore en leur centre manifestent depuis qu’elles ont été aménagées – et jusque dans l’oubli de leur fonction – le pouvoir fondateur qu’un peuple réalise dès qu’il se voit, même pour quelques heures, même pour quelques jours, attroupé, agrégé, amassé. E
Les places libres que de nombreuses villes connaissent encore en leur centre manifestent depuis qu’elles ont été aménagées – et jusque dans l’oubli de leur fonction – le pouvoir fondateur qu’un peuple réalise dès qu’il se voit, même pour quelques heures, même pour quelques jours, attroupé, agrégé, amassé. E